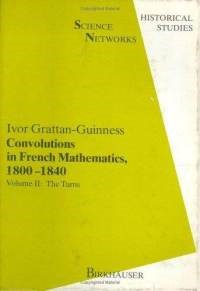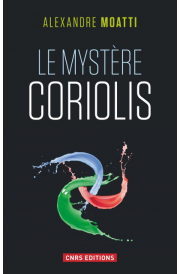L’ingénieur-savant, 1800-1830
- INFORMATION
- ACTUALITÉ
- ANALYSE
- EN SAVOIR PLUS
- À TÉLÉCHARGER
« Loi concernant les Écoles de service public », du 30 Vendémiaire de l’an 4 (22 octobre 1795) de la République française, une et indivisible.
1795
Entre 1794 (création de l’École polytechnique) et 1830, une catégorie particulière anima un âge d’or de la science en France : celle des « ingénieurs-savants ». Savants → ingénieurs, ils appliquent leurs connaissances scientifiques à l’industrie issue de la révolution industrielle. En retour (plus original), ingénieurs → savants, ils créent de nouvelles branches de la science fondamentale en les nourrissant de leurs résultats « de terrain ».
Hommage à Ivor Grattan-Guinness (1941-2014)
Ivor Grattan-Guinness, philosophe et historien des sciences britannique, est mort le 12 décembre 2014. Ses domaines de spécialité étaient multiples, il était esprit porté à la réflexion sur de nombreux sujets. Il a passé sa carrière principalement à la Middlesex University, et était éditeur pendant de nombreuses années de la revue Historia Mathematica.
Il était auteur BibNum, voulant mieux faire connaître un de ces scientifiques français de l’Empire, parmi ceux qu’il avait tout particulièrement étudiés, Louis Poinsot (1777-1859): son analyse (publiée en janvier 2013) porte sur le premier chapitre des Eléments de statique de Poinsot (1803), texte fondateur de la statique. Il en avait fait un article dans Historia Mathematica, paru début 2014 (“From anomaly to fundament: Louis Poinsot’s theories of the couple in mechanics”).
Ivor Grattan-Guinness était un très fin connaisseur de cette période de la science en France, après la création des grandes écoles (École polytechnique notamment) par la Révolution. Ses ouvrages Convolutions in French mathematics, 1800-1840 (Birkhaüser 1990) en constituent une analyse détaillée et profonde : à partir d’un travail sur archives et documents d’époque, il y entre dans de nombreux détails sur les carrières des savants de cette période, ou sur les institutions (École polytechnique, Académie, diverses revues).
La notion d’ingénieur-savant qu’il propose dans son article Science in Context 1993 (“The ingénieur savant, 1800–1830 A Neglected Figure in the History of French Mathematics and Science”) est une grille de lecture remarquable des parcours et des œuvres (et leurs mutuelles “convolutions”) de cette époque. Pour l’expliquer brièvement : à la charnière entre théorie et pratique, ainsi qu’entre mathématique et physique, ils sont [savants → ingénieurs], appliquant leurs connaissances scientifiques aux techniques et métiers de la révolution industrielle – et ils sont aussi dans l’autre sens [ingénieurs → savants], créant de nouvelles branches de la science fondamentale en les nourrissant de leurs résultats “ de terrain” (mécanique appliquée, théorie des machines, hydraulique, résistance des matériaux, aussi ce qui s’appellera plus tard thermodynamique,…).
Il détaillait bien cette catégorie d’ingénieurs-savants, très spécifiques à cette époque et à l’École polytechnique de Monge, les comparant aux plus classiques et pérennes “savants académiques”, classant les divers savants dans chaque catégorie – certains pouvant varier dans leur carrière. Les ingénieurs-savants, ce sont Coriolis, Navier, Saint-Venant, le second Poncelet (celui des roues et des turbines), Clapeyron, le premier Lamé (celui des voussures et de la résistance des matériaux, en Russie), Sadi Carnot,…; les savants plus classiquement académiques, polytechniciens eux aussi, ce sont Biot, Arago, Poisson, Poinsot, le premier Poncelet (celui de la géométrie), Cauchy,…
Son analyse n’était pas exempte d’humour (britannique ?), quand il expliquait que cette figure d’ingénieur-savant ait pu être “négligée”, dans l’historiographie, par une forme d’aversion des historiens, et de nos sociétés en général, envers les mathématiques, je cite (Grattan-Guinness 1993, concl.): « As far as the history of science is concerned, the main reason is mathsphobia, which affects its historians as it does society in general. »
Ce n’était qu’une partie de son champ de compétences : mais sa connaissance, à la fois globale, profonde et détaillée – en trois dimensions – des savants et des institutions scientifiques de cette période 1795-1850 nous manquera.
Qu’il repose en paix, au paradis des penseurs.
Alexandre Moatti
(blog BibNum, 27 décembre 2014)
Historien des mathématiques et de la logique, Ivor Grattan-Guinness (1941-2014), est professeur émérite de l’Université du Middlesex. Il a écrit des ouvrages de référence sur l’histoire des sciences en France entre 1795 et 1840. Il a par ailleurs dirigé de nombreuses revues de grande réputation en philosophie des sciences. Il est membre de l’Académie internationale d’histoire des sciences.
Figure 1 : Ivor Grattan-Guinness (1941-2014) (à Paris en 2003, photo WikiCommons, auteur Gate220) ; 1bis ci-dessous : le titre de l’article originel de Grattan-Guinness dans Science in Context (1993).
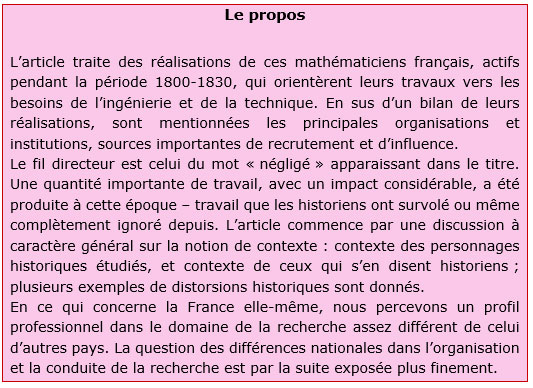
1. Contexte et méta-contexte
1.1 Généralités
Parmi les divers sujets méthodologiques et interdisciplinaires que cette revue[1] analyse, je me focalise ici sur la notion de contexte, à la fois de manière générale et par le biais d’une étude de cas. Qu’est-ce qu’une bonne théorie du contexte en historiographie ? Selon moi, elle devrait impliquer et mêler les éléments suivants :
- des facteurs « internes » et « externes » (pour rappeler un débat animé, portant sur les choix et priorités, d’il y a une vingtaine d’années – pour ma part, quoique nouvel arrivant dans le domaine, j’ai toujours soupçonné que ce débat était beaucoup trop simpliste) ;
- l’aptitude scientifique et les ambitions de la figure historique étudiée ;
- sa compétence – et son absence de compétence – dans le domaine scientifique qu’il pratiquait ;
- ses talents – ou son absence de talents – théorique, mathématique et/ou expérimental ;
- sa formation académique et sa carrière, et leurs conséquences – ou leur absence de conséquences – sur ses travaux de recherche ;
- ses compétences linguistiques ;
- les pressions professionnelles qu’il avait à subir – ou non – pour publier, ou pour son avancement ;
- enfin les idéologies, philosophies, les facteurs politiques et religieux, susceptibles d’avoir un impact – y compris en dehors du domaine des travaux scientifiques.
En outre, le contexte se rapporte à la fois aux figures historiques étudiées et à leurs historiens. Ce qui amène au titre de la présente sous-section ; l’historien devrait tâcher de comprendre son propre méta-contexte lorsqu’il étudie les situations contextuelles de ses personnages historiques. Il devrait avoir présents à l’esprit ses propres aptitude, ambitions, (in)compétence dans le domaine scientifique étudié, (absence de) talents, formation, carrière, dextérité linguistique, pressions professionnelles s’exerçant sur lui, idéologies, etc.
Le présent article traite du contexte d’un groupe spécifique de savants, mais son axe principal est celui des conséquences méta-contextuelles du mot négligé, apparaissant dans le titre. Les personnages que je mentionnerai étaient bien connus et parfois même célèbres de leur temps, mais la plupart d’entre eux se trouvent de longue date derrière l’horizon d’étude des historiens.
La principale raison de cette évanescence est que ces personnages étaient avant tout des mathématiciens, et œuvraient donc dans une branche de la science que les historiens choisissent quasi-systématiquement d’ignorer ou de survoler. La profession dite d’« histoire des sciences » apparaît d’ailleurs assez déséquilibrée : elle porte sur la physique, sur la chimie, sur l’astronomie observationnelle, sur la biologie, sur la géologie, ainsi que sur les sciences humaines ; mais la médecine est traitée séparément, tandis que l’ingénierie et la technologie ont tendance eux aussi à avoir une vie autonome. Cependant les mathématiques restent quasiment hors du champ de vision, notamment pour le xviiie siècle et au-delà, quand les analyses peuvent devenir assez difficiles[2]. Les travaux sur l’histoire des mathématiques progressent – l’accroissement d’activité a été à cet égard assez remarquable pendant les quinze dernières années – mais ses contributeurs doivent vraiment communiquer plus entre eux.
En ce qui concerne l’histoire des sciences, la principale raison en est une mathophobie, qui affecte les historiens comme elle affecte la société en général (la détestation contraire, l’historiophobie, affecte tout autant les mathématiciens). Le résultat laisse apparaître un immense contraste. L’histoire des sciences, en tant que collection de phénomènes du passé, en inclut de nombreux pour lesquels les mathématiques ont joué un rôle important voire déterminant (notamment dans de nombreux domaines de la physique) ; mais l’histoire des sciences, en tant qu’activité « professionnelle » contemporaine, n’évoque jamais les mathématiques avec la force qu’elles ont eue, voire même ne les évoque jamais. La conséquence est claire : le méta-contexte ne permet pas de rendre compte des contextes historiques dans lesquels les mathématiques ont un rôle prééminent ; l’ « histoire » de troisième zone qui en résulte nous en dit plus sur les historiens que sur le passé.
1.2 L’étude de cas
Dans cet article, je me propose d’examiner une tranche d’histoire, dont l’étude (ou plutôt l’étude déficiente) est une exemplification de cette distorsion métacontextuelle et de cette « mathophobie ». Il s’agit de la communauté de mathématiciens qui œuvre en France pendant les années 1800-1830. À cette époque, une grande importance était accordée aux mathématiques, au niveau de l’éducation comme de la recherche : une cohorte de mathématiciens remarquables apparaît alors en France (principalement à Paris). Sur quatre générations, plus d’une trentaine de personnalités majeures peuvent être identifiées, ainsi que quelques autres scientifiques plus mineurs quoiqu’intéressants. À titre de comparaison, dans les autres pays, jusqu’au début des années 1820, seule une poignée de mathématiciens était à l’œuvre. Cette prééminence française se traduit certes par ces personnalités historiques, mais aussi par les initiatives prises pour constituer des institutions de formation à la science, et de pratique – d’un type et à une échelle inexistants dans les autres pays. De fait, tous les plus jeunes membres de cette cohorte étaient le produit de ce nouveau système d’éducation – les membres les plus âgés ayant été leurs enseignants ; à leur tour la majorité d’entre eux devinrent à la fois les enseignants et les stratèges d’une politique scientifique à destination de la génération suivante.
La question principale réside dans le développement et les applications du calcul. Les sujets liés au calcul (fonctions et séries, méthodes numériques, théorie des équations) prennent une extension considérable, dans la nature des problèmes posés, comme dans leur résolution par équations différentielles. Ils furent regroupés sous l’ombrelle d’une discipline générale, de nos jours appelée « analyse mathématiques », elle-même reposant sur une version beaucoup plus élaborée de la théorie des limites. Le principal domaine d’application du calcul – la mécanique – était aussi largement étendu : astronomie mathématique, mécanique céleste, théorie des machines, mécanique moléculaire. Les principes relatifs à l’énergie et la théorie de l’élasticité furent profondément modifiés. De plus, la mécanique s’étendit à la physique mathématique, avec les premières mathématisations de la théorie de la chaleur, de l’optique, de l’électricité et du magnétisme (avec leur rapprochement dans l’électromagnétisme). Nous discuterons du contexte de la géométrie en partie 4.3.
Cette tranche d’histoire sur laquelle je souhaite donner un éclairage a été négligée même dans l’histoire des mathématiques, et de la science en tant que telle. Lorsqu’on considère cette période des mathématiques, on s’intéresse généralement aux quelques mathématiciens qui bâtirent les fondations du calcul et de l’analyse mathématiques, de la mécanique céleste, de l’optique ondulatoire, de l’électrodynamique, etc. Bien au contraire, dans cet article, je prends en considération ce groupe d’ingénieurs-savants (pour utiliser une expression de l’époque[3]) – ces mathématiciens et scientifiques qui travaillèrent dans le domaine professionnel de l’ingénierie (ainsi que dans son orbite éducative). L’ingénieur-savant était motivé dans sa recherche par les sujets relatifs à l’ingénierie, et souvent adaptait sa recherche à la résolution des besoins techniques. Un contraste important émergera entre les contextes prééminents de l’ingénieur-savant dans la science française et sa quasi-absence de notre compréhension historique de la période – cette figure a été négligée aussi bien dans sa face mathématicien que dans sa face ingénieur.
En termes modernes, le domaine de travail de l’ingénieur-savant serait appelé « mécanique de l’ingénieur », ou « ingénierie de la mécanique » ; l’autre définition, celle de l’ingénieur civil, n’est pas adaptée, car le domaine de l’ingénieur-savant s’étendait aussi au militaire (je rappelle cette importante tradition dans la section 5.4 ci-après). J’étendrai le terme « ingénierie » aussi à la technologie. Je dois toutefois remarquer qu’il y avait évidemment des ingénieurs-savants qui n’utilisaient pratiquement pas les mathématiques ; par exemple, le technicien chimiste[4]. « Ingénieur-savant mathématicien » pourrait donc être une locution plus adaptée ; mais comme elle est assez lourde, nous nous en tiendrons à « ingénieur-savant » – sachant que sa composante « mathématique » sera toujours implicite à défaut d’être explicite.
La distinction entre l’ingénieur-savant et ses collègues mathématiciens plus orientés vers la théorie est le sujet de la section qui suit. Dans la section 3, nous examinons les institutions dans lesquelles il travaille et les revues dans lesquelles il publie le plus souvent. Les sections 4 et 5 donnent des exemples significatifs des activités dans lesquelles il est déterminant – d’abord dans des contextes scientifiques où ses collègues plus théoriques œuvraient aussi, ensuite dans des contextes qui lui sont propres. Enfin, la section 6 envisage deux questions méta-contextuelles : la nature descriptive ou explicative du scénario historique proposé ici ; le sujet d’un supposé déclin de la science en France après 1830.
La littérature primaire est très riche mais très étendue et complexe ; la littérature secondaire est plutôt modeste (une conséquence de la « négligence » évoquée ci-dessus). Les références données ici[5] se rapportent à des éléments de littérature secondaire par trop négligés jusqu’à présent, ou contenant des éléments d’interprétation intéressants, voire des bibliographies à valeur ajoutée. Pour des références et des développements plus détaillés sur les divers aspects de cette histoire, je renvoie à mon ouvrage historique sur la période[6] – allant jusqu’à 1840, en fait. Sa bibliographie contient plus de 300 items de littératures primaire et secondaire, et je ne puis ne serait-ce que commencer à entrer dans cette jungle ici. Le présent article tâche d’aller au-delà du livre (et de quelques articles y afférant), principalement en explorant le potentiel du contexte et du méta-contexte en tant qu’outils historiographiques, dans lesquels facteurs internes et externes se mêlent.
2. Deux groupes dans une communauté
2.1 Les individus
Le tableau 1 donne les principaux mathématiciens de la période 1800-1830, séparés en fonction de leurs intérêts de recherche, suivant les deux groupes évoqués précédemment. Je désignerai ces groupes sous le nom de CMI (calcul/ mécanique/ ingénierie) et AMP (analyse mathématique/ physique), acronymes des têtes de colonnes du tableau. Le premier groupe comprend les ingénieurs-savants. J’insiste sur le fait que ces intérêts de recherche sont l’unique critère de classification : les situations professionnelles ou les amitiés auraient pu conduire à une vue très différente ! Le tableau exclut l’auteur de manuels S.F. Lacroix, car il fut peu chercheur (ses centres d’intérêt sont à rattacher au groupe AMP), ainsi que F. Arago, dont les travaux de recherche ont peu mobilisé les mathématiques, bien qu’il fût assez compétent dans le domaine et qu’il les enseignât dans plusieurs cours à Polytechnique (nous discutons de cela en section 3.1).
Tableau 1. Principaux mathématiciens de la période 1800-1830, triés suivant les deux centres d’intérêts étudiés ici.
Les préoccupations de l’ingénieur-savant ont déjà été brièvement décrites. Il se concentrait quasi exclusivement sur la mécanique, le calcul, et les sujets y afférant. À l’intérieur de la mécanique, sa motivation d’ingénieur le conduisit à se spécialiser dans l’étude du frottement, la résistance des matériaux, l’équilibre des voûtes, la construction de ponts, de quais, et les travaux de terrassement. Il s’intéressait aussi à l’hydraulique, avec une attention particulière aux turbines ou roues hydrauliques, ainsi qu’à la construction de canaux et à leur entretien. En astronomie mathématique, il s’occupait de la production de tables de calcul – et en mécanique céleste à des productions similaires sur les marées ou à des analyses détaillées de cartographie ou de géodésie. En analyse, ou en théorie des équations, il montra un intérêt particulier aux méthodes numériques : équations aux différences, méthodes de résolution par interpolation, par séries partielles, par approximation de racines. Il était aussi attiré par la géométrie descriptive, qui était soutenue de manière enthousiaste par ses collègues Hachette et Monge.
Les figures tutélaires de l’ingénieur-savant étaient Ch. de Coulomb, J.-C. Borda et Lazare Carnot. Les deux premiers ne figurent pas dans le tableau, pour des raisons chronologiques ; Borda[7] meurt en 1799, et la carrière de Coulomb était quasi terminée après 1800 – il meurt en 1806. Sa position vis-à-vis de la science et de la communauté scientifique est néanmoins très intéressante : ceci est discuté en section 6.1.
Figure 2 : Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)
En tant que mathématicien, l’ingénieur-savant était pour sûr compétent mais pas génial ; Navier et Poncelet furent les plus impressionnants techniquement, Dupin fut très astucieux pendant sa (brève) période mathématique, Carnot et Coriolis furent les plus profonds penseurs, sur les sujets les plus généraux.
À l’inverse, les membres du groupe AMP furent principalement intéressés par des applications plus générales et plus théoriques des mathématiques, et/ou par les mathématiques pures. Les figures marquantes en sont Lagrange et Laplace – avec en arrière-plan L. Euler, ainsi que J. Le Rond d’Alembert ou D. Bernoulli. Ils furent aux sources mêmes : de la mutation du calcul vers l’analyse mathématique (Cauchy) ; de celle de la mécanique vers la physique mathématique, via la mathématisation de la théorie de la chaleur (Fourier, Laplace, Poisson) ; de l’optique physique (Malus, Biot, Fresnel) ; de l’électricité et du magnétisme (Biot, Poisson), ainsi que de leur interconnexion, à partir de 1820 (Ampère). L’ingénieur-savant, quant à lui, contribua très peu à ces nouveaux domaine – Hachette toutefois prit quelqu’intérêt à l’électricité et au magnétisme.
Les mathématiciens AMP furent de loin plus puissamment créatifs que leurs collègues ingénieurs. Mais ils étaient généralement moins intéressés par la pratique expérimentale et, dans certains cas, incompétents pour s’y livrer – Fresnel et Malus sont les seules exceptions, de taille, et Ampère imaginait avec astuce certains arrangements expérimentaux. Ils s’attaquaient rarement à des problèmes d’ingénieur, bien que certains eussent pu appliquer leur savoir à de tels sujets – comme Fresnel sur l’éclairage des phares, ou des quais du nouveau port de Paris (voir section 5.1).
Il convient de remarquer que le partage entre ces deux groupes ne recoupe pas le partage moderne entre mathématiques pures et appliquées ; il se fait principalement à l’intérieur des mathématiques appliquées[8]. Le partage contemporain (et regrettable) émerge à la fin du xixe siècle, conséquence de la professionnalisation toujours croissante des mathématiques (et de la science en général) – dont nous voyons là, de fait, les premiers jalons, au début du siècle.
Le partage de cette communauté en ces deux groupes est tranché ; les principales exceptions ont déjà été évoquées. Ce point est rediscuté en section 6.1.
2.2 Un nouveau partage des centres d’intérêt scientifiques
Les nouveaux progrès de la mathématisation accomplis par le groupe AMP, et les centres d’intérêt spécifiques des ingénieurs-savants, montrent que la traditionnelle (et tout à fait correcte) distinction faite à propos de la science jusqu’en 1800 entre ses tendances baconiennes (où l’expérience prime, et les mathématiques jouent un rôle mineur) et ses tendances classiques (où c’est l’inverse) – qui caractérise bien la physique jusqu’en 1800[9] – ne s’applique plus par la suite. En particulier, la physique était, jusqu’au xviiie siècle inclus, une science très largement non-mathématique, traitant de gravité, de chaleur, des propriétés et des états de la matière, de l’optique, de l’électrostatique, du magnétisme ou de l’hygrométrie ; de plus, elle était peu considérée parmi les diverses sciences – à l’inverse des mathématiques, qui tenaient le haut du pavé, ou de la chimie. Le groupe AMP, notamment Laplace et ses successeurs Biot, Malus et Poisson, ainsi que des chimistes tels que C.-L. Berthollet, se souciait dans les années 1800 de rehausser la place de la physique[10].
Le schéma 1 expose la situation avant et après l’avènement de la physique mathématique. Les deux lignes verticales fines représentent les liens existant avant 1800 entre d’une part les mathématiques et les sciences classiques, d’autre part la pratique expérimentale et les sciences baconiennes. Les six lignes plus épaisses montrent les liens s’appliquant après 1800 : le groupe AMP (MAP) s’attaque aux deux types de sciences, avec un intérêt bien plus fort pour les mathématiques que pour l’aspect expérimental ; alors que leurs collègues CMI (CME) restent en général fidèles aux sciences classiques mais accordent un égal intérêt aux mathématiques et à l’expérience (ou l’équivalent dans leur contexte : le dessin, la construction, la modélisation d’objets). Je recommande le modèle ainsi décrit aux historiens des sciences, aussi bien dans le cas de la France que de celui d’autres pays ; à noter cependant que ce modèle prend les mathématiques au sérieux.
Schéma 1 : Représentation des connexions traditionnelles (lignes fines), et des nouvelles connexions (lignes appuyées).
3. Institutions et publications
La principale cause de la professionnalisation croissante durant cette période est la création ou la renaissance, après la Révolution, d’institutions éducatives et/ou professionnelles dans lesquelles la science de l’ingénieur était très importante. Comme notre contexte historique a été lourdement influencé par cette organisation nationale, et le (non-)développement de diverses institutions, il paraît utile de les recenser ici[11].
3.1 Les institutions éducatives
Lors de la Révolution, un certain nombre d’institutions éducatives furent abolies, ou leur activité suspendue. Un nouveau système bipartite fut progressivement développé : les Grandes écoles (comme elles seront désignées par la suite) et l’Université, telle qu’elle fut nommée dès son institution en 1808. Cette dernière appellation était impropre, car ce n’était pas une université dans le sens usuel, mais un réseau d’écoles étendu sur tout l’Empire (ou ayant vocation à s’y étendre) – parmi celles-ci, l’enseignement de plus haut niveau relevait de facultés réparties sur le territoire de l’Empire français, ainsi qu’un enseignement d’élite donné à l’École normale à Paris. Le Collège Royal (Paris), rebaptisé Collège de France en 1795, était quant à lui un centre d’enseignement de haut niveau, non rattaché aux deux pôles décrits ci-dessus. En matière de science et de technologie, les universités étaient clairement moins cotées que les grandes écoles, qui étaient alors organisées autour des besoins de l’ingénierie ; les aspects relatifs à l’éducation du présent article sont consacrés.
La plus célèbre de ces grandes écoles est l’École polytechnique, qui fut fondée en 1794 comme école préparatoire de formation des étudiants aux travaux publics et à l’armement militaire. Malgré de nombreuses difficultés initiales, elle s’assura rapidement une haute réputation, et son modèle fut même transposé dans d’autres pays. Fin 1804, le consul Bonaparte étant devenu l’empereur Napoléon, il donna un statut militaire à l’école, même si les travaux publics restaient dans ses attributions. Des savants réputés de l’époque (y compris ceux qui relevaient des sciences de l’ingénieur) furent recrutés comme professeurs ou examinateurs, et la plupart des plus jeunes personnalités listées en tableau I y furent étudiants.
Figure 3 : Napoléon Ier rend visite à l’École polytechnique, en 1814 pendant les Cent-Jours (image SABIX).
Dès le départ, les mathématiques furent le principal sujet enseigné. Cependant, il y eut très tôt des querelles entre les partisans d’une formation calquée sur les besoins du métier d’ingénieur et les partisans d’une formation scientifique plus générale et plus théorique. Progressivement c’est cette dernière vision qui prévalut, Laplace (du groupe AMP) triomphant de Monge (du groupe CMI). En particulier, la géométrie descriptive devint presque un accident de parcours – le fait que Monge en donnât un enseignement fort théorique explique aisément son déclin. À nouveau, sont là à l’œuvre des rivalités au sein même de l’enseignement des sciences de l’ingénieur, non seulement à Polytechnique mais dans les ministères, à propos de l’équilibre à atteindre entre formation pour les travaux publics et formation militaire.
Une fois diplômé, le polytechnicien s’orientait généralement vers une école d’ingénieurs spécialisée appelée « école d’application ». Un réseau d’une dizaine de ces établissements, situés pour la plupart en dehors de Paris, s’est développé au début des années 1800. Contrairement à la fameuse École polytechnique, ils n’ont été que peu étudiés, et c’est à l’École des Mines[12] que l’on a accordé le plus d’attention ; mais ce sont l’École des Ponts et Chaussées à Paris et l’École militaire de Metz qui jouent les rôles principaux de notre histoire. Ce n’est qu’au cours des dernières années que la première a fait l’objet d’une véritable attention[13], tandis que la seconde n’a toujours pas été étudiée[14]. Certains historiens de l’éducation française passent entièrement sous silence l’existence de ce réseau d’écoles, même s’ils font mention des établissements qui le constituaient.
Cette structure pédagogique se centrait sur les travaux publics et l’ingénierie militaire ; pour une raison ou pour une autre, le gouvernement ne soutenait pas beaucoup l’ingénierie industrielle et commerciale. En contrepartie, de nombreuses institutions ont été créées sous la forme d’initiatives privées, dont certaines juste après la Révolution ; nous mentionnerons ici les principales d’entre elles.
Figure 4 : Médaille du Conservatoire national des arts et métiers. Il fut créé le 19 Vendémiaire an III (1794) (image WikiCommons, auteure Estelle Binant, cc-by-sa 4.0).
Premièrement, le Conservatoire des Arts et Métiers a été créé en 1799 pour servir de dépôt aux conceptions et aux instruments. Il fournissait également un enseignement d’un niveau moins élevé, notamment après 1819, quand une réforme lui permit d’embaucher trois nouveaux professeurs. L’un d’entre eux était Dupin, qui enseignait « la géométrie et la mécanique » d’une part, et était fortement impliqué dans les affaires publiques concernant l’éducation et l’économie d’autre part, publiant fréquemment dans de nombreuses revues, parmi celles listées dans le tableau 2 ci-dessous[15]. Une de ses initiatives fut lancée en 1825 : un programme national de cours élémentaires gratuits en géométrie et en mécanique pour les classes ouvrières devait être dispensé par des polytechniciens qui serviraient ensuite en tant qu’ingénieurs professionnels, et basés dans tout le pays. Cette initiative précéda l’Association polytechnique de Paris, dont on se souvient mieux aujourd’hui, organisée à partir de 1830 par le polytechnicien A. Comte et d’autres, ainsi que son équivalent de province, l’Association philotechnique.
Figure 5 : Couverture du Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale publié en 1820 (19e année). Cette société existe toujours, ayant son siège place Saint-Germain-des-Prés (Paris VIe)
Deuxièmement, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale fait honneur à son nom depuis sa création en 1802, proposant de nombreux prix pour la résolution de problèmes et publiant une revue annuelle importante, le Bulletin. Cependant, aucune école supérieure particulière ne vit le jour jusqu’à ce que l’École Centrale des Arts et Manufactures n'ait commencé à couvrir plus spécifiquement ces domaines de l’ingénierie, en 1829. Notons que cette initiative était d’origine privée, mais après un démarrage difficile, elle reçut des aides publiques et gagna rapidement en prestige[16].
3.2 Institutions professionnelles et publications
D’un point de vue professionnel, il existait de nombreux corps de génie civil[17], notamment les Ponts et Chaussées[18] et les Mines. Ces dernières sont moins significatives pour nos travaux sur cette époque, avec Combes comme praticien le plus important[19]. Des corps spéciaux existaient également, tels que le Bureau des Longitudes pour l’astronomie et la navigation[20]. Par ailleurs, l’Armée et la Marine militaire et civile représentaient des employeurs prestigieux ; le Dépôt Général de la Guerre, spécialisé en cartographie et en géodésie, faisait notamment partie de l’armée.
En général, un ingénieur faisant carrière dans le civil servait dans plusieurs départements français de province (s’il avait beaucoup de chance, il se retrouvait à Paris ou dans les environs) et gravissait les échelons administratifs[21] ; son homologue militaire progressait dans les grades correspondants[22]. Certains aspiraient à la réputation de savant en écrivant des manuels ou (plus probablement) des traités ou des monographies sur des sujets, projets, batailles ou campagnes particuliers, et/ou en contribuant à des publications ou des revues spécialisées, dont nous traiterons brièvement.
Parmi les sociétés scientifiques, l’Académie des Sciences (mieux connue en tant que Première classe de l’Institut de France entre 1795 et 1816) était l’établissement chic par excellence, objectif principal des ambitions professionnelles. Un détail intéressant peut être mentionné ici. De façon générale, l’élection des membres ingénieurs-savants se déroulait à un âge nettement plus avancé qu’au sein du groupe AMP. Il semble donc que d’un point de vue professionnel, il ait été préférable de se consacrer aux mathématiques cérébrales à Paris plutôt que de s’adonner à des activités d’ingénierie, possiblement en province (moralité : ne connaissez rien de vraiment utile, cela pourrait être mis en pratique). Ce type de facteurs a très certainement encouragé la scission entre les mathématiques pures et les mathématiques appliquées au cours du xixe siècle au sein de la communauté mathématique en plein essor, en France comme ailleurs.
Une autre manifestation majeure du développement d’une profession est la publication de livres et d’articles. Il semble que le livre ait été une branche importante du commerce[23], à laquelle les ingénieurs-savants ont très certainement contribué. Quant aux articles, certains de leurs travaux étaient publiés dans les revues habituelles : Mémoires de l’Académie, Journal de l’École polytechnique, Bulletin de la Société philomathique tenu par une société scientifique parisienne et permettant la publication rapide d’articles courts, etc. Il y avait également des périodiques centrés sur leurs spécialités (dont l’ingénierie industrielle et commerciale) et adressés aux institutions dont ils faisaient partie.
Le tableau 2 ci-après liste les principales publications de cette période (et un peu plus tard). Une fois de plus, nombre d’entre elles sont peu connues ; ainsi, elles sont rarement citées dans les écrits historiques. De plus, pour une raison que je n’ai pas encore pu déterminer mais qui illustre bien notre problématique méta-contextuelle, certaines ne sont même pas citées dans le Royal Society Catalogue of Scientific Papers. En comparaison, les Annales des arts et manufactures (56 vol., 1800-1815, environ 400 pages chacun pour la plupart) ont été tellement populaires en leur temps qu’elles ont été réimprimées deux fois avant 1818[24].
Tableau 2
Quant aux livres, il s’agissait de manuels, de monographies et de traités, dans les genres habituels. Parmi les auteurs principaux, nous retrouvons Prony, dont la Nouvelle architecture hydraulique (1790-96) constituait la source de références principale en mécanique de l’ingénieur, de même que la Mécanique analytique (1788) de Lagrange et les quatre premiers volumes de la Mécanique céleste (1799-1805) de Laplace ont influencé les travaux du groupe AMP. Prony a également publié les cours qu’il dispensait en mécanique à l'École polytechnique en plusieurs volumes. Les manuels de Hachette portaient sur la géométrie descriptive, les machines et la physique, des matières relatives à son enseignement à l’École.
Figure 6 : Gaspard Riche de Prony (1755-1839), ingénieur-savant.
Chose étrange, Prony n’a rédigé aucun manuel pour l’École des Ponts et Chaussées, dont il a pourtant été directeur à partir de 1798 et jusqu’à sa mort en 1839. Navier tient ici le haut du pavé, avec la publication des cours sur la mécanique et les matériaux qu’il a dispensés à l’École après sa nomination, venue à point nommé, en 1819 (pour le contexte, voir sous-section 4.2). Francœur a été l’auteur de nombreux manuels sur les aspects de la mécanique, principalement destinés aux étudiants en ingénierie. Les manuels de Dupin ainsi que ses nombreux autres livrets et publications étaient centrés sur ses activités au Conservatoire des Arts et Métiers, mentionnés dans la sous-section 3.1. Le rôle de Poncelet en tant qu’auteur sera traité plus spécifiquement dans les sous-sections 4.1 et 5.4, tandis que nous nous pencherons sur les résultats obtenus par son groupe dans les deux sections suivantes.
4. Chevauchements entre les deux groupes
4.1 Les divers aspects de la mécanique
Dans la sous-section 2.2, nous avons souligné les différences de motivation et d’approche entre les membres de deux groupes ; les conflits et les différends sont parfois parfaitement évidents. Ceci est particulièrement vrai pour la mécanique, principal domaine de chevauchement entre les deux groupes.
Autour des années 1800, trois traditions principales existaient en mécanique[25]. La première était née des trois lois de Newton sur le repos et le mouvement. La seconde, soutenue notamment par Lagrange et constituant les prémisses de ce qui sera plus tard connu sous le nom de « mécanique variationnelle », s’appuyait sur des principes tels que ceux de d’Alembert, où l’action et la vélocité virtuelle étaient moins présentes, et impliquait de nombreux calculs de variations. Enfin, la troisième se basait sur la conservation de l’énergie ou, pour utiliser le terme de l’époque, la(les) force(s) vive(s). Ces trois théories étaient en situation de compétition acharnée, aussi bien du point de vue de leurs fondements que de leurs principes (avec en particulier les cas de déséquilibre tels que l’impact, et les situations d’équilibre).
Certaines différences étaient évidentes dans le domaine de la statique. Tandis que le groupe AMP se préoccupait de prouver la loi du levier ou le parallélogramme des forces de diverses façons, et que Poinsot allait apporter une contribution significative en la matière grâce à sa compréhension éclairée des deux problématiques dans son remarquable manuel Éléments de statique (première édition, 1803), la fraternité CMI se focalisait sur des problématiques telles que la stabilité des digues et des arches[26].
Figure 7 : Un parallèlogramme de forces, extrait de Poinsot [1803]. On trouvera une analyse par I. Grattan-Guinness du chapitre Ier des Éléments de statique de Poinsot sur BibNum (janvier 2013, lien).
Les ingénieurs-savants s’approprièrent la troisième tradition pour les besoins de la dynamique, donnant ainsi un exemple important de l’influence de l’ingénierie sur la science[27]. Suivant la tradition anti-Lagrange lancée par Carnot dans les années 1780, Navier, Poncelet et Coriolis soulignèrent l’importance de la conservation de l’énergie, mais aussi de sa perte en cas d’impact, au cours des années 1810 et 1820. La théorie des machines prouva clairement que l’impact et la percussion étaient des facteurs de base, et ce pour tous les aspects de la mécanique ; que la dynamique était première, et que la statique en était un cas particulier ; et que l’inter-convertibilité de l’énergie et du travail était le principe référent de base. En effet, c’est Coriolis qui proposa ici le mot « travail » comme terme technique, et qui suggéra de définir la « force vive » comme la moitié de la valeur alors admise, masse × (vélocité)². Un élément notable du positivisme (comme l’appela alors, de façon fort peu originale, leur contemporain Comte, polytechnicien de son état) était évident dans cette approche ; par exemple, on préférait le « travail » à la « force vive » comme concept, car un produit simple (force × distance) est empiriquement préférable à la quelque peu indétectable (vélocité)².
Figure 8 : Gaspard-Gustave de Coriolis (1792-1843, X1808), ingénieur-savant.
4.2 Quelques cas particuliers en mécanique
Ailleurs, on peut trouver des cas où des membres de chaque groupe traitaient du même domaine de la mécanique, mais d’une façon qui reflétait leur différence d’approche. Par exemple, lorsque les membres AMP Laplace (en 1803) et Poisson (à la fin des années 1830) étudièrent les projectiles, ils déployèrent des schémas de mouvement et fixèrent des cadres de référence pour prendre en compte la rotation de la Terre (et, dans le cas de Poisson, également la rotation du projectile) ainsi que la résistance de l’air. Ils produisirent des analyses fascinantes qui donnèrent un très bon aperçu des systèmes en mouvement (par exemple, Laplace prit en compte la force de Coriolis avant que Coriolis lui-même ne la déterminât en 1835 comme une conséquence de la mécanique énergétique) et inspirèrent Léon Foucault, vers le milieu du siècle, dans sa démonstration de la rotation de la Terre[28]. Cependant, les équations différentielles impliquées étaient trop compliquées pour des applications pratiques telles que la télémétrie pour l’artillerie. La préférence a donc été donnée à un traitement plus simple et ingénieux de 1772, omettant la rotation de la Terre, mis au point par Borda[29].
La démonstration de Foucault consistait en la fameuse expérience avec le pendule long. L’histoire de l’utilisation de cet instrument montre également l’influence de Borda ; en effet, suite à la mise au point de nouveaux poids et mesures dans les années 1790, il conçut un pendule « simple » des plus sophistiqués qui était loin d’être simple, au vu de l’attention qu’il portait à la stabilité et aux variations dans la pression barométrique et de son utilisation du télescope pour détecter les moments de coïncidence avec une horloge de contrôle.
Les modes de théorisation sur le pendule montrent très clairement les différences d’approche entre les deux groupes. Les membres CMI utilisaient cet instrument et la théorie correspondante (esquissée par Borda et par d’autres), principalement pour la topographie et l’arpentage, avec le « cercle répétiteur » de Borda, théodolite des plus raffinés contenant différentes fonctions permettant de réduire les erreurs d’observation[30]. De plus, également en rapport avec l’étude des poids et mesures, Prony proposa un pendule plus élaboré, aujourd’hui connu sous le terme de « compensé », utilisant trois points de suspension possibles, et esquissa la théorie correspondante.
Figure 9 : Cercle répétiteur de l’ingénieur et navigateur Borda (1733-1799) (timbre allemand, 1981).
En revanche, ce sont des membres du groupe AMP (une fois de plus Laplace et Poisson) qui entreprirent en 1810 des analyses sophistiquées d’effets, qu’ils espéraient peu importants, utilisant des équations différentielles. Ils étudièrent la différence entre la bascule ascendante et descendante, la vitesse angulaire à la fin de l’oscillation, la rotation du fil de suspension autour du pendule, etc., pour s’assurer que les effets étaient aussi faibles qu’ils l’espéraient[31].
Figure 10 : Siméon-Denis Poisson (1781-1840, X1798), un des représentants de proue du groupe MAP.
Le dernier exemple est ici celui de la théorie de l’élasticité qui a éveillé un vif intérêt chez les Français autour des années 1810. Les lignes, fibres et barres élastiques ont été analysées en profondeur par Euler et d’autres au cours du xviiie siècle, mais les théories des surfaces et des corps ainsi que des fluides visqueux étaient bien plus fragmentaires. La plupart des travaux de cette période ont été réalisés par des membres AMP : Germain et Poisson au début des années 1810, Poisson et Cauchy dans les années 1820 ; la modélisation de la contrainte/déformation élaborée par ce dernier (pour utiliser les termes tardifs de Rankine) dans la cadre de la théorie linéaire est venue couronner ces efforts. Certains de ces travaux, en particulier ceux de Poisson, étaient relatifs à la mécanique moléculaire (sous-section 1.2), avec la thèse selon laquelle les propriétés élastiques sont le résultat de modifications de la structure moléculaire supposée d’un objet élastique. Aucun de ces travaux ne permit de démontrer la thèse du membre CMI Dupin, exprimée dès 1813, que la courbure du bois n’est pas une propriété linéaire[32].
Cependant, le collègue CMI de Dupin, Navier, apporta lui aussi quelques contributions essentielles à la théorie linéaire dans les années 1819-1822[33]. Il déclara même que l’approche de Cauchy en représentait « la meilleure analogie » quand il les présenta pour la première fois en 1822. Cette affirmation était une exagération typique de la tradition parisienne de revendication des droits de propriété intellectuelle, sur au moins un point important[34]. En effet, alors que Navier avait supposé que la somme des forces sur une surface se répartissait toujours le long de sa normale, Cauchy (extrapolant en partie des études de Fresnel en optique) réalisa que cette direction pouvait être oblique.
Figure 11 : Claude Henri Navier (1785-1836, X1802), ingénieur-savant.
Mais ce qui nous intéresse plus dans le cadre de notre étude, ce sont les différences de motivations qui ont amené à produire des théories largement similaires. Professionnellement parlant, Cauchy et Navier appartenaient tous deux au Corps des Ponts et Chaussées ; mais tandis que Cauchy n’y avait plus œuvré depuis dix ans et s’était pleinement consacré à l’enseignement et à la recherche, Navier avait continué la pratique en tant qu’ingénieur. Ainsi, Cauchy était motivé dans ses études par la possibilité de déployer des techniques mathématiques sophistiquées (et par les découvertes de Fresnel), alors que Navier s’intéressait à l’élasticité pour ses applications dans les propriétés en flexion des matériaux (qu’il a enseignées de façon détaillée à l’École des Ponts et Chaussées[35]).
Un des principaux centres d’intérêts de Navier à l’époque était la conception d’un pont à suspension, première structure de ce type nouveau à Paris. Malheureusement, il s’affaissa partiellement en 1826 pendant la construction, et le chantier fut annulé. L’utilité des mathématiques dans l’ingénierie fut remise en question[36] : ce ne fut ni la première ni la dernière fois.
4.3 Contexte de la géométrie
Le calcul et la mécanique sont les principales branches des mathématiques concernées par notre histoire ; mais nous devons également mentionner la géométrie de l’époque, car elle formait une autre branche majeure et concernait certains membres des deux groupes. On dénombrait quatre principaux types de géométrie, distincts mais qui se chevauchaient partiellement.
Premièrement, la « géométrie analytique » a fait son chemin jusqu’aux manuels avec de nombreux volumes populaires classés dans cette catégorie, rédigés par Biot, Lacroix et d’autres[37]. Cette matière élémentaire était utilisée par les membres de deux groupes. Le calcul était peu ou pas utilisé.
Deuxièmement, la « géométrie différentielle » constituait une extension de la géométrie analytique, pour utiliser l’appellation moderne (à l’époque, on la désignait avec des expressions telles que « analyse appliquée à la géométrie »). Le calcul était utilisé pour étudier les propriétés de lignes et de surfaces dans l’espace. Elle était souvent appliquée par divers membres de la communauté mathématique, probablement plus fréquemment par le groupe AMP dans ses analyses de l’éther et de l’élasticité. Par ailleurs, Cauchy en a affiné les composantes fondamentales dans son enseignement à l’École polytechnique. Cependant, un autre de ses grands exposants était Monge[38].
Figure 12 : Gaspard Monge (1746-1818), un des principaux fondateurs de l’École polytechnique, et inspirateur des « ingénieurs-savants ».
On se souvient mieux de Monge pour le troisième type de géométrie, la « géométrie descriptive », une théorie portant sur les sections planes en configurations tridimensionnelles[39]. Outil précieux pour l’ingénierie que Monge souhaita élever au rang de branche des mathématiques. Malheureusement, elle manquait de contenu mathématique pour atteindre ce statut ; et il lui donna un aspect trop théorique plein de problèmes ennuyeux tels que la recherche du nombre d’ellipsoïdes qui peuvent en toucher trois autres donnés, de l’intérieur ou de l’extérieur. Il suscita un intérêt nul, voire une opposition, en particulier à l’École polytechnique. Les réserves de Laplace (mentionnées à la sous-section 3.1) menèrent à la réduction du temps d’enseignement que les programmes d’études lui consacraient, et son statut au sein des mathématiques en général se dégrada[40]. Certains membres CMI (mais pas tous), en particulier Hachette et Olivier, défendirent son importance et soulignèrent son applicabilité ; et parmi leurs collègues, Dupin s’en servit avec beaucoup de talent dans plusieurs situations ; quelques membres AMP l’enseignèrent pour l’argent. Bien que Monge lui ait fait plus de publicité qu’à la géométrie différentielle, il s’agit sans doute de sa contribution la moins durable à cette branche.
Enfin émergea la « géométrie projective » (pas sous ce nom, mais le mot « projective » a été utilisé), dont la géométrie descriptive a été un moteur majeur. L’idée était de traiter de façon générale des propriétés géométriques qui changeaient ou non sous l’action de transformations continues de configuration. Parmi les savants français, L. Carnot en a été une figure de proue, suivi notamment par Poncelet dans les années 1810 ; d’autres parmi leurs contemporains ont également apporté leur contribution. Leurs résultats se cantonnaient la plupart du temps aux sections coniques, mais des courbes plus générales ont également été prises en compte avec l’important développement du sujet tout au long du siècle[41].
Bien que l’empirisme fût un dénominateur commun d’envergure dans le plaidoyer français en faveur de la géométrie[42], il faut souligner que des différences tout aussi importantes existaient également, et c’est là que la distinction que nous avons établie entre nos deux groupes de savants s’avère très utile. Tout le monde pouvait se servir de la géométrie analytique et différentielle, en cas de besoin : mais seuls les membres CMI s’enthousiasmaient pour la descriptive. De plus, la géométrie projective avait un caractère largement « pur », dans la mesure où elle n’était pas appliquée à la mécanique ou à l’ingénierie ; en fait, la plupart du temps, c’est la géométrie descriptive qui remplissait ce rôle. Ce dernier point est développé dans la sous-section 5.4 sur l’exemple de Poncelet, avec une revue de ses principaux écrits en géométrie projective.
Figure 13 : Jean-Victor Poncelet (1788-1867, X1807), ingénieur-savant et mathématicien.
4.4 Quelques cas pédagogiques
Les exemples que nous venons de citer ont tous été puisés dans la recherche scientifique. Ci-dessous, nous avons choisi quelques cas de contraste entre les deux groupes, où les aspects pédagogiques et/ou professionnels sont proéminents.
Prony nous fournit deux exemples pertinents lors de son passage à l’École polytechnique. En 1794, il fut l’un des premiers, avec Lagrange, à y être nommé professeur d’analyse et de mécanique. Mais il y avait un très fort contraste entre son enseignement des mathématiques différentielles et les discussions raffinées de Lagrange sur le développement en séries entières et les solutions aux équations différentielles, et il allait critiquer le caractère inadapté à l’école de l’enseignement de Lagrange[43]. Trente ans plus tard, il faisait partie du jury d’examen de fin d’études, travaillant avec son ancien élève Cauchy, devenu professeur ; dans de longs rapports écrits[44] entre 1826 et 1829, il a violemment attaqué l’enseignement de Cauchy, le jugeant une fois de plus inadapté.
Une des critiques de Prony montre très bien les différences entre les deux groupes ; en effet, il souhaitait que les étudiants apprissent le flux des fluides en hydrauliques dans les termes théoriques que lui et les autres avaient élaborés. Ils s’appuyaient sur « l’hypothèse des couches parallèles » selon laquelle le corps fluide se déplace par échelons dans des couches infinitésimales, donnant un modèle pouvant être soumis à une analyse simple par des méthodes différentielles. Cauchy, quant à lui, enseignait une théorie basée sur les « filaments incurvés » des fluides, probablement bien plus véridique et liée à ses propres études hydrodynamiques sur les vastes étendues d’eau autour de 1815[45], mais qui dépassait la compétence des étudiants.
5. Quelques préoccupations propres à l’ingénieur-savant
5.1 Hydraulique
Prony s’est lui-même penché de près sur le flux de l’eau, dans le cadre du projet hydraulique majeur du Premier Empire (puis pendant la période suivante, à savoir la Restauration, 1815-1830) : le projet du canal de l’Ourcq (1802-1825)[46].
Figure 14 : Ouvrage descriptif du canal de l’Ourcq par P.-S. Girard (1812).
Ce projet a permis non seulement de créer un canal menant de la rivière de l’Ourcq à Paris, mais aussi d’établir un port à La Villette, juste à l’extérieur des murs de la ville, ainsi que deux canaux au nord et au sud du port pour le relier à la Seine. Le canal sud (canal Saint-Martin) passait par la rive droite de la ville, des systèmes secondaires et tertiaires y ont donc été greffés pour améliorer la disponibilité de l’eau dans la ville de Paris, dont la taille et la population augmentaient rapidement. À l’époque de l’Empire, le projet a été dirigé par Girard. Malgré son importance majeure à l’époque, toute cette entreprise semble avoir pratiquement disparu des connaissances historiques : jusqu’à aujourd’hui, seul Girard en a été lui-même un historien majeur[47].
Girard et de Prony ont consacré beaucoup d’attention à la science hydraulique, en particulier au début des années 1800, avec de nombreuses hypothèses différentes : hypothèse des couches parallèles, vitesse du flux de l’eau en tant que fonction de la pente du corps aqueux selon laquelle la vélocité de l’eau diffère selon la profondeur, taux du flux s’écoulant d’orifices comme fonction (mais laquelle ?!) de la forme et de la position de l’orifice dans le contenant, etc. Contrairement aux grandes équations différentielles utilisées en hydrodynamique, la théorisation s’appuyait partiellement sur des formules empiriques et des analogies plutôt grossières avec les études menées sur la friction[48].
5.2 Cartographie et topographie
Un autre projet majeur de cette époque était la conception d’une nouvelle carte de France[49]. L’instigateur principal était Louis Puissant, membre du Dépôt Général de la Guerre. Sa disparition de la perspective historique est particulièrement malheureuse[50], car il s’agissait de la figure majeure (pas seulement en France) des domaines de la cartographie et de la topographie, au cours de la période qui nous concerne. Il est l’auteur de traités importants (Traité de géodésie et Traité de topographie, premières éditions en 1805 et 1807, puis réédités dans les années 1820), il a dirigé l’École des Géographes de 1809 à 1833[51], et, surtout, il a conçu le projet de la nouvelle carte et a été fortement impliqué dans son élaboration. Le Mémorial du Dépôt Général de la Guerre a consacré trois volumes aux détails de ce projet (1832, 1840 et 1853, les deux premiers ayant été édités par Puissant lui-même) qui a pris plusieurs dizaines d’années et a fourni du travail à des douzaines d’ingénieurs-savants géographes pour la réalisation de tous ses détails minutieux.
Puissant opta pour une projection conique qui permettait de réduire la déformation des zones sur les latitudes françaises. Il plaça le sommet sur le pôle terrestre, définit la latitude moyenne à 45° et aligna la longitude rectifiée sur l’Observatoire de Paris. La carte fut préparée avec moult détails relatifs à la cartographie et à la triangulation. L’exégèse de la projection, en particulier le calcul des caractéristiques minutieuses, tout en tenant compte de la sphéricité de la Terre, faisait appel à la trigonométrie sphérique (appuyée par quelques théorèmes élégants produits par Legendre, un collègue AMP) et au développement des variables en séries entières tronquées pour atteindre le niveau souhaité de précision, avec un bon quota de géométrie différentielle.
D’un point de vue mathématique, le projet de Puissant dépeint très bien l’intérêt de l’ingénieur-savant pour les méthodes approximatives et numériques. Les questions telles que le nombre de décimales requises et les taux comparatifs de convergence entre les séries disponibles étaient souvent la préoccupation mathématique principale de l’ingénieur-savant, dans des contextes et des applications qui se présentaient bien plus rarement pour le groupe AMP.
Cependant, aucun de nos ingénieurs-savants ne produisit de nouveaux résultats ou méthodes d’importance durable pour l’analyse numérique. Au contraire, une apothéose absurde de l’obsession pour le calcul fut atteinte au cours des années 1790, quand Prony dirigea une équipe énorme afin de calculer des tables logarithmiques et trigonométriques monumentales. Ces travaux furent réalisés en relation avec le bureau du Cadastre, pour lequel la cartographie était une fois encore un élément important. Le projet fut conçu et dirigé en suivant explicitement les principes d’Adam Smith sur la division du travail, avec une équipe répartie en trois groupes. Le premier choisit la formule mathématique pour calculer les nombres et vérifier leur exactitude après calcul (pour une raison ou une autre, Prony décida d’utiliser un curieux méli-mélo de formules), et détermina le nombre de décimales requises. Le second prépara les feuilles de calcul, mit en place les premières lignes et colonnes de nombres, et réalisa les vérifications. Le troisième passa littéralement ses journées à faire des additions et des soustractions pour remplir les feuilles de calcul ; il était composé de dizaines d’anciens coiffeurs qui avaient perdu leur emploi après que la Révolution eut interdit certains styles capillaires. Finalement, dix-huit volumes furent produits, répartis dans deux ensembles calculés à partir de deux formules différentes, avec des valeurs allant jusqu’à vingt-neuf décimales. Le destin de ce projet montre qu’en sciences, le jeu des perles de verre n’est pas réservé aux théoriciens ; Prony n’a jamais expliqué pourquoi son projet nécessitait des tables de dimensions aussi titanesques dont la publication intégrale s'avéra finalement trop onéreuse, malgré de nombreuses tentatives[52].
5.3 Optimisation de l’ingénierie
Au cours de la Restauration, certains ingénieurs-savants s’impliquèrent dans des problèmes liés à l’efficacité des artéfacts et des constructions, comme Girard pour le meilleur nombre d’écluses sur un canal, ou Navier sur les avantages du nouveau moyen de transport que représentaient les chemins de fer[53]. D’un point de vue mathématique, ces problèmes étaient habituellement résolus par le biais des recherches de deuxième et troisième plan pour optimiser telle ou telle fonction. Cependant, Lamé et Clapeyron développèrent remarquablement ces idées pendant un service de dix ans à Saint-Pétersbourg, en publiant en 1829 un article sur le point d’équilibre qui exprimait très clairement le « problème de l’entrepôt » (comme on l’appelle parfois aujourd’hui dans la recherche opérationnelle). Ils proposèrent une solution qui s’appuyait sur un modèle mécanique de poids suspendus à des poulies (et théoriquement basée sur le principe de la vélocité virtuelle mentionné dans la sous-section 4.1). Malheureusement, leur article ne fut publié que dans la revue russe, méconnue, de l’institution où ils travaillaient, et n’eut donc aucune influence, même pas sur leurs propres carrières[54]. Il fallut attendre encore près d’un siècle avant que des avancées significatives soient réalisées sur ce sujet majeur.
Figure 15 : Émile Clapeyron (1799-1864, X1815), ingénieur-savant.
5.4 Le rôle de Poncelet
Ce dernier exemple montre lui aussi la diffusion de la science française en-dehors de Paris. Dans la sous-section 4.1, nous avons mentionné le rôle de Poncelet dans le développement de la mécanique énergétique, processus initié à l’École militaire de Metz où il enseigna de 1825 à 1833. Il produisit rapidement des versions lithographiées de ses cours, ainsi qu’un Cours de mécanique industrielle publié à Metz en 1829, partiellement fondé sur les cours dispensés aux travailleurs de Metz dans le cadre de l’initiative inspirée par Dupin décrite à la sous-section 3.1. Plus tard, des versions corrigées des cours lithographiés et des cours publiés sont apparues en provenance de Metz, puis de Paris, avec des éditions posthumes de ces derniers dans les années 1870. De plus, des versions illégales commencèrent à apparaître chez les imprimeries belges dès les années 1830.
Figure 16 : Une des premières éditions du cours de Poncelet à Metz (image Gallica/BnF)
Poncelet appliqua également ses principes de mécanique énergétique à de nombreux problèmes particuliers d’ingénierie, aussi bien à des fins civiles que militaires. Son concept d’une roue à eau à pales incurvées, vers le milieu des années 1820, lui valut un prix de l’Académie et éveilla un grand intérêt par ailleurs. Il encouragea ensuite ses collègues à entreprendre des recherches variées en friction et en hydraulique, à l’École de Metz ou avec la participation de celle-ci, puis à Paris et ailleurs dans le monde. Parmi eux, Morin était la principale figure, I. Didion, G. Piobert et J. A. Lesbros étant également impliqués.
Figure 17 : Roue à aubes courbes de type Poncelet (moulin de Lutterbach, Alsace)
Aucune étude systématique de ce mouvement admirable et remarquable qui a duré près d’un demi-siècle[55] n’a été entreprise, et l'on se souvient principalement de Poncelet pour ses contributions (importantes) à la géométrie projective, ce qui illustre notre méconnaissance des mathématiques de l’ingénieur français. La distorsion méta-contextuelle est frappante, surtout si l’on se souvient que la plupart de ces applications ne concernent pas la géométrie projective, comme nous l’avons vu à la sous-section 4.3. Poncelet lui-même illustre bien l'absence d’interaction, dans les deux directions, car son enseignement et ses travaux de recherche en mécanique mettaient à profit les trois autres types de géométries décrits à la sous-section 4.3. Les titres mêmes de ses principaux livres sur la géométrie projective mettent en évidence aussi bien les divisions que les connections. Par exemple, dans Applications d’analyse et de géométrie (1862-64), il a démontré de quelle façon les géométries analytique, descriptive et (en minorité) différentielle peuvent être utilisées pour obtenir les résultats « qui ont servi, en 1822, de principal fondement » au Traité des propriétés projectives des figures (1865-66). Ce livra fut décrit comme « un ouvrage utile à ceux qui s’occupent des applications de la géométrie descriptive et d’opérations géométriques sur le terrain » (mes italiques), comme contexte pour une théorie géométrique plus générale[56]. En d’autres termes, il y a eu deux Poncelet, tous deux géomètres, mais travaillant dans des contextes et avec des objectifs différents.
6. Remarques finales
Comme nous l’avons souligné dans la sous-section 1.2, l’objet historiographique de cet article se cristallise dans des situations où les problématiques contextuelles et méta-contextuelles occupent une place majeure. Deux types de conclusions s’en suivent.
6.1 La division de la communauté
Comme mentionné à la fin de la sous-section 2.1, la division en deux groupes est tout à fait heureuse au vu du nombre de savants impliqués et de la diversité de leurs talents. Elle est d’autant plus nette que les membres de la communauté provenaient du même pays, vivaient à la même époque, avaient pour la plupart reçu la même éducation à l’École polytechnique et dans les écoles qui lui ont succédé, et ont travaillé dans le même cadre professionnel émergent. Cependant, ils ont décidé d’évoluer dans l’un des deux camps intellectuels présentés dans le tableau 1. Un lien de cause à effet pourrait exister ici : la structure sociale et institutionnelle de la science française de l’époque semble avoir « forcé » les savants à choisir entre les deux groupes.
Voici deux contrexemples instructifs. Le premier est Coulomb qui n’appartient à aucun des deux groupes, car ses travaux de recherches concernaient l’électricité et le magnétisme ainsi que la mécanique de l’ingénieur[57] ; cependant, il était un scientifique du dix-huitième siècle, c’est-à-dire du régime prérévolutionnaire, comme mentionné dans la sous-section 2.1. Le deuxième est le cas de Lamé et Clapeyron qui apparaissent dans le tableau 1, mais dans des groupes différents. Cette division reflète fidèlement l’évolution de leurs carrières professionnelles respectives après leur retour en France en 1831, mais au cours des dix ans passés à Saint-Pétersbourg, ils coécrivirent de nombreux articles (ce qui représente en soi une caractéristique inhabituelle pour des mathématiciens) s’inscrivant dans les thématiques de recherche des deux groupes, et plus particulièrement en mécanique[58]. Si tel avait été son souhait, Lamé aurait très certainement pu poursuivre sa carrière en tant qu’ingénieur-savant après son retour à Paris ; au lieu de cela, mis à part quelques autres collaborations avec Clapeyron (d’une nature le plus souvent descriptive, concernant les chemins de fer et les politiques éducatives), il consacra entièrement ses recherches aux problématiques ressortissant au groupe AMP, et en devint un membre aussi distingué qu’un autre parmi sa génération ou la génération suivante.
Figure 18 : Gabriel Lamé (1795-1870, X1814), ingénieur-savant (CMI) puis mathématicien (AMP).
Pourquoi cette division d’intérêt intellectuel était-elle si strictement respectée en France ? La question est surtout intéressante du point de vue méta-contextuel, dans la mesure où bien qu’il soit indubitablement présent, le statut de l’ingénieur, (dans le monde scientifique et) au sein de la société, n’était pas souvent sujet à discussion. Quand on l’abordait, c’était en tant que profession dans sa globalité, et non en tant que petite minorité à talent académique[59]. Sans tenir compte des penchants purement personnels pour des axes de recherche particuliers, le système d’organisation professionnelle très centralisé[60] et organisé en écoles et en corps garantissait un niveau bien plus élevé à l’ingénieur que dans les autres pays, lui offrant ainsi l’opportunité de devenir un savant si tel était son désir académique. Cependant, la question de l’échec/la réticence/l’incompétence/… du savant à œuvrer dans les deux groupes au cours de sa carrière de chercheur me semble peu claire[61].
La question historique posée ici est d’autant plus importante si l’on considère les figures majeures des autres pays qui se sont intéressées à ces domaines, au cours de la même période ou après celle-ci. En effet, certains d’entre eux travaillaient d’une façon différente de chacun des deux groupes français, mais pouvaient fonctionner des deux côtés. Il est intéressant de voir qu’ils avaient tendance à œuvrer d’une façon vaguement similaire au groupe auquel se rattachaient leurs travaux, chevauchant plutôt que réfutant la division représentée en figure 1. Parmi les premiers scientifiques de ce genre versatile, nous retrouvons C. F. Gauss[62], W. Whewell[63], G. B. Airy[64] et W. Thomson[65].
Ainsi, le scénario décrit dans cet article est aussi bien explicatif que descriptif. Mais où, parmi les courants profonds de la science et de la société françaises, se trouve la réponse ? « Je confesse ici mon ignorance » (comme l’a si éloquemment exprimé Saint-Augustin il y a des siècles de cela). Des questions contextuelles de fond concernant la direction nationale et les différences inter-nationales se posent ici ; nous les rencontrons sans cesse, particulièrement dans l’étude de la science du XIXe siècle, et elles mériteraient toute l’attention de l’historiographe.
6.2 La science française sur le déclin
En ce qui concerne la France elle-même, les points généraux que nous avons abordés peuvent influencer la deuxième question avec laquelle nous allons clôturer cet article. Les historiens le savent, la science française a amorcé un net déclin après 1830, et diverses explications ont été proposées ; mais, bien entendu, les mathématiques sont entièrement omises ou presque, de même que bon nombre de domaines de l’ingénierie[66]. Il s’agit cependant d’une déformation inacceptable du contexte qui en empêche une évaluation appropriée. Il est indispensable d’accorder une place majeure aux disciplines allant des mathématiques à l’ingénierie et à la technologie, en passant par la mécanique, que ce soit au niveau de la recherche, de l’éducation ou des institutions.
Quand les mathématiques et leurs conséquences pour l’ingénierie sont étudiées dans le cadre de l’histoire des sciences françaises, des doutes se font jour quant à la portée et même à la nature du déclin. En particulier, on remarque une considérable amélioration dans la mécanique de l’ingénieur (autour de Poncelet et de la nouvelle école pour le génie industriel et civil abordée à la section 3.1), aussi bien en termes de qualité que de quantité d’activité à partir des années 1830. Une fois de plus, une des caractéristiques de cette période est que de nombreuses théories ont été découvertes dans les années 1800 et 1810, prêtant un caractère « spectaculaire » à ces travaux ; les consolidations ultérieures, qui suivaient telle ou telle ligne « normale », ne se faisaient pas autant remarquer, mais il ne s’agissait pas pour autant d'une science « plus facile » pour les personnages historiques impliqués. De plus, une grande partie de ce prétendu déclin semble être une illusion d’optique, provoquée par l’épanouissement des mathématiques très rapide dans d'autres pays au cours des années 1820 ; ceci est également vrai pour les autres disciplines scientifiques.
Expliquer les choses ne doit cependant pas revenir à les minimiser, car de vrais éléments de déclin étaient également présents. Au niveau de la recherche, nous pourrions citer l’échec du groupe AMP (et des physiciens) à développer les recherches de Fresnel et l’électrodynamique d’Ampère ; l’initiative de ce développement a été largement prise à l’étranger. Quant à l’ingénierie, la préférence donnée par les structures institutionnelles aux travaux publics et à la branche militaire, au détriment du commerce et de l’industrie, ont constitué un désavantage grandissant au fur et à mesure que la Révolution industrielle progressait. Dans le domaine de l’éducation, nous pouvons mentionner la pétrification des programmes de l’École polytechnique, ainsi que son statut incohérent d’institution hautement prestigieuse, n’enseignant que la science et les mathématiques élémentaires, à des étudiants dont les plus talentueux ne s’intéressaient le plus souvent pas du tout au domaine militaire ou à l’ingénierie (en fait, pour des raisons que je n’ai pu déterminer, ce flux de savants en herbe prometteurs s’est considérablement tari à partir des années 1810). De plus, l’échec global du système universitaire (sous-section 3.1) à adapter un quelconque domaine de l’ingénierie pour l’enseigner à un public éducable issu du peuple était culturellement malheureux[67]. Enfin, le compartimentage et l'absence de « chevaucheurs de groupes » parmi les savants français, abordée à la sous-section 6.1, peuvent également avoir contribué au déclin, bien qu’on ne puisse pas l’affirmer avec certitude, étant donné que les personnages aux talents aussi diversifiés étaient peu fréquents ailleurs aussi.
Malgré quelques signes évidents de déclin, je reste persuadé que ce déclin a été grandement exagéré, et que s'en faire l'avocat résulte autant que l’ignorance des historiens que d'une forme d’échec français. Ironiquement, on peut le soumettre à une analyse historique à part entière : le déclin semble avoir été mis en avant à partir des années 1860 environ, par la communauté pédagogique française elle-même, comme une position en partie vraie, mais exagérée, afin d’améliorer les niveaux de financement et de recrutement. Les historiens successifs n’ont pas réussi à tracer ses origines historiques, et l’ont donc considéré comme vrai sans réserve (et pour ne pas dire sans fondement historique)[68].
La phobie des mathématiques chez les historiens (ou quelque chose d’approchant, j’imagine) les a empêchés de fournir une approximation valable des faits relatifs à la question du déclin ; non seulement les ingénieurs-savants CMI sont largement absents des analyses, mais leurs collègues AMP aussi, dont l'activité était plus théorique (ainsi que de nombreux autres personnages importants qui, à l’origine, ne travaillaient ni dans l’analyse ni dans la physique mathématique). De plus, de nombreuses institutions scientifiques françaises ne peuvent pas être correctement abordées sans une analyse en bonne et due forme de l’importance (peut-être excessive) qu’elles apportent à tel ou tel type de mathématiques.
Les opinions doivent être revues, notamment en ce qui concerne la place de l’ingénieur-savant au sein des sciences en France. Ceci nécessite une mise en contexte adéquate et ce à grande échelle, non seulement pour la période étudiée dans cet article, mais aussi pour la question ultérieure du déclin. Il est bien triste de constater de telles lacunes ; après tout, nous sommes supposés travailler sur deux siècles d’histoire d’un pays scientifique majeur.
![]()
(article original 1993;
traduction française, publiée par BibNum juin 2016)
Remerciements
En plus des conseils reçus au cours des années de la part de nombreux collègues sur les problématiques abordées ici, les rapports de deux évaluateurs de l’article m'ont ouvert de nouvelles perspectives.
Liste des références
- Acloque, P., Oscillation et stabilité selon Foucault…, Paris : CNRS, 1981.
- Airy, G. B., Mathematical Tracts…, 1ère édition, Cambridge : Deighton, 1826.
- Airy, G. B., « Tides and Waves », dans Encylopaedia metropolitana, 1845, 5:241*-396*.
- Artz, F. B., The Development of Technical Education in France, 1500-1850, Cambridge, Mass. : MIT Press, 1966.
- Barnard, H., Military Schools and Courses of Instruction in the Science and Art of War…, 2pts, Philadelphie : Lippincott, 1862.
- Barnard, H., Systems, Institutions and Statistics of Public Instruction in Different Countries, 2pts., New York : Steiger, 1872.
- Ben-David, J., « The Rise and Decline of France as a Scientific Centre », Minerva 8, 1970, p.160-79.
- Berthaut, H. M. A, La carte de France, 1750-1898 : Étude historique. 2 vols, Paris : Service géographique, 1898-99.
- Berthaut, H. M. A, Les ingénieurs géographes militaires, 1624-1831 : Étude historique, Paris : Service géographique, 1902.
- Bigourdan, G., « Le Bureau des Longitudes… », Annuaire du Bureau des Longitudes, 1828-31. 1928 : A1-72 ; 1929 : C1-92 ; 1930 : A1-110 ; 1931 : A1-145 ; 1932 : A1-117 ; 1933 : A1-91.
- Booker, P. J., A History of Engineering Drawing, Londres : Chatto and Windus ; réédition, Bury St. Edmunds : Northgate, [1963] 1978.
- Boyer, C. B., History of Analytic Geometry, New York : Scripta Mathematica, 1956.
- Bradley, M., « Franco-Russian Engineering Links : The Careers of Lamé and Clapeyron, 1820-1830 », Annals of Science 38, 1981, p. 291-312.
- Bradley, M., « Gaspard-Clair-François-Marie Riche de Prony », thèse de doctorat, Council for National Academic Awards, Londres, 1984.
- Bradley, M., « Civil Engineering and Social Change : The Early History of the Paris École des Ponts et Chaussées », History of Education 14, 1985, p. 171-83.
- Bret, P., « Le Dépôt Général de la Guerre et la formation scientifique des ingénieurs-géographes militaires en France (1789-1820) », Annals of Science 48, 1991, p. 113-57.
- Crosland, M. P., The Society of Arcueil…, Londres : Heinemann, 1967.
- Daston, L., « The Physicalist Tradition in Early Nineteenth-Century French Geometry », Studies in the History and Philosophy of Science 17, 1986, p. 269-95.
- de Prony, G.-C.-F.-M. Riche, « Brunacci », Bibliographie universelle ancienne et moderne 59, 1835, p. 363-67.
- Dhombres, J. G., « French Mathematical Textbooks from Euler to Cauchy », Historia scientorum 28, 1985, p. 91-137.
- Fourcy (-Gaudain), A. L., Histoire de L’École polytechnique, Paris : École polytechnique, 1828 ; réédité chez Paris : Belin, avec les notes de J. G. Dhombres, 1927.
- Franksen, O. I, et I. Grattan-Guinness, « The Earliest Contribution to Location Theory : A Memoir by Lamé and Clapeyron, 1829 », Mathematics and Computers in Simulation 31, 1989, p. 195-220.
- Fuller, A. T. (éd.), Stability of Motion, Londres : Taylor and Francis, 1975.
- Gauss, C. F., Theoria motus corporum coelestium, Hamburg : Perthus and Besser, 1809 ; réédité dans Gauss, Werke, Leipzig : Teubner, 7, 1933, p. 1-282.
- Geppert, H., « Über Gauss’s Arbeiten zur Mechanik und Potentialtheorie », dans C. F. Gauss, Werke, vol. 10, partie 2, Leipzig : Teubner, 61 p., 1933.
- Gillmor, C. S., Charles Augustin Coulomb…, Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1971.
- Girard, P. S, Mémoires sur le canal de l’Ourcq…, 2 volumes et atlas en 2 volumes, Paris : Carilain-Goeury (le volume 2 est paru en posthume, édité par L.-J. Favier), 1831-43. »
- Glas, E., « On the Dynamics of Mathematical Change in the Case of Monge and the French Revaolution », Study in the History and Philosophy of Science 17, 1986, p. 249-68.
- Grattan-Guinness, I., « Work for the Workers : Advances in Engineering Mechanics and Construction in France, 1800-1830 », Annals of Science 41, 1984, p. 1-33.
- Grattan-Guinness, I., « Mathematics and Mathematical Physics at Cambridge, 1815-40… », dans Wranglers and Physicits…, P. Harman (éd.), Manchester : Manchester University Press, 1985, p. 84-111.
- Grattan-Guinness, I., « Grandes écoles, petite Université : Some Puzzled Remarks on Higher Education in Mathematics in France, 1795-1840 », History of Universities 7, 1988, p. 197-225.
- Grattan-Guinness, I., « Modes and Manners of Applied Mathematics : The Case of Mechanics », dans D. Rowe, J. McCleary (éds.), History of Modern Mathematics, vol. 2, New York : Academic Press, 1989, p. 109-26.
- Grattan-Guinness, I., Convolutions in French Mathematics, 1800-1840 : From the Calculus and Mechanics to Mathematical Analysis and Mathematical Physics, 3 vol., Basel : Birkhäuser ; Berlin, DDR : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1990a.
- Grattan-Guinness, I., « Does History of Science Treat of the history of science ? The case of Mathematics », History of Science 28, 1990b, p. 149-73.
- Grattan-Guinness, I., « The Varieties of Mechanics by 1800 », Historia mathematica 17, 1990c, p. 313-38.
- Grattan-Guinness, I., « Work for the Hairdressers : The Production of de Prony’s Logarithmic and Trigonometric Tables », Annals of the History of Computing 12, 1990d, p. 177-85.
- Heyman, J., Coulomb’s Memoir on Statics. An Essay on the History of Civil Engineering, Cambridge : Cambridge University Press, 1972.
- Hulin-Jung, N., L’organisation de l’enseignement des sciences : la voie ouverte par le second Empire, Paris : Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1989.
- Journal général de l’imprimerie et de la librairie, volume des années 1811-12, Paris.
- Konvitz, J., Cartography in France 1660-1848…, Chicago : University of Chicago Press, 1987.
- Kötter, E., « Die Entwickelung der syntetischen Geometrie von Monge bis auf Staudt (1847) », Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 5, partie 2, 1901.
- Kötter, F. W. F., « Die Entwicklung der Lehre vom Erddruck », Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 2, 1892, p. 77-154.
- Kuhn, T. S., « Mathematical vs. Experimental Traditions in the Development of Physical Science », Journal of Interdisciplinary Sciences 7, 1976-77, p. 7-31. Également paru dans Kuhn, The Essential Tension, Chicago et Londres : University of Chicago Press, p. 31-65.
- « Lettre au Directeur du Journal » et « Réponse du Directeur du Journal », Journal du génie civil, des sciences et des arts 4, 1829, p. 143-57.
- Locqueneux, R., « Charles Combes (1801-1872)… », Archives internationales d’histoire des sciences 40, 1990, p. 11-29.
- Loria, G., Storia della geometria descrittiva…, Milan : Hoepli, 1921.
- Mascart, J. L., La vie et les travaux du Chevalier Jean-Charles Borda (1733-1799)…, Lyon (en tant que Annales de l’Université de Lyon, n. s., sec. 2 [droit, lettres], fascicule 33), 1919.
- Mouret, E. J. G., « Antoine de Chézy : Histoire d’une formule d’hydraulique », Annales des ponts et chaussées, vol. 1, 1921, p. 165-269.
- Outram D., « Politics and Vocation : French Science 1793-1830 », British Journal for the History of Science 13, 1980, p. 27-43.
- Paul, H., « The Issue of Decline in the Nineteenth-Century French Science », French Historical Studies 7, 1972, p. 416-51.
- Paul, M., Gaspard Monges « Géométrie Descriptive » und die École Polytechnique…, Bielefeld : Institut für Didaktik der Mathematik, 1980.
- Petot, J., Histoire de l’administration des Ponts et Chaussées, 1599-1815, Paris : Rivière, 1958.
- Picon, A., « Les ingénieurs et la mathématisation. L’exemple du génie civil et de la construction », Revue d’histoire des sciences 42, 1988, p. 155-72.
- Poncelet, J. V., Lettre de démission de sa chaire à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris, dans H. Tribout, Un grand savant : Le général Jean-Victor Poncelet, 1788-1867, Paris : Suffroy, p. 122-25. Publié à l’origine dans Monsieur universel, p. 868 (manuscrit aux Archives nationales, F17 21524).
- Poncelet, J. V., « Examen critique et historique des principales théories ou solutions concernant l’équilibre des voûtes », Comptes-rendus de l’Académie des Sciences 35, 1852, p. 495-502, 531-40, 577-87.
- Pothier, F., Histoire de l’École Centrale des Arts et Manufactures…, Paris : Delamotte, 1887.
- « Quelques réflexions » et « Nouvelles réflexions » [sur l’administration du Corps des Ponts et Chaussées], Journal du génie civil, des sciences et des arts 2, 1829, p. 119-28, 350-59.
- Rühlmann, M., Vorträge zur Geschichte der theoretischen Maschinenlehre… 2 parties, Braunschweig : Schwetschke, 1881-85.
- Smith, C., et N. Wise, Energy and Empire : A Biographical Study of Lord Kelvin, Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
- Smith, C. O., « The Longest Run : Public Engineers and Planning in France », American Historical Review 95, 1990, p. 657-92.
- Smith, J. G., The Origins and Early Development of the Heavy Chemical Industry in France, Oxford : Clarendon Press, 1979.
- « Survey of the French Educational System », Quarterly Journal of Education 2, 1831, p. 83-113. Publié à l’origine dans le Bulletin universel des sciences et de l’industrie, sciences géographiques, canaux, voyages 24, 1830, p. 267-310.
- Taton, R., L’œuvre scientifique de Monge, Paris : Presses universitaires de France, 1951.
- Thomson, W., « On the Dynamical Theory of Heat… », Transactions of the Royal Society of Edinburgh 20, 1851-53, p. 261-98, 475-82 ; réédité dans Mathematical and Physical Papers 1, 1882, p. 174-232.
- Thomson, W., « The Tide Gauge, Tidal Harmonic Analyser, and Tide Predictor », Minutes of the Proceedings of the Institute of Civil Engineers, 1882, p. 2-25 ; réédité dans Mathematical and Physical Papers 6, 1911, p. 272-305, édité par J. Larmor.
- Todhunter, I., A History of the Theory of Elasticity and the Strenght of Materials, vol. 1, édité par K. Pearson, Cambridge : Cambridge University Press, 1886 ; réédité dans New York : Dover, 1960.
- Weiss, J. H., The Making of Technological Man : The Social Origins of French Engineering Education. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1982.
- [Whewell, W.], « Theory of Electricity », dans Encyclopaedia Metropolitana 4, 1830, p. 140-70 (non signé).
- Whewell, W., Mechanics of Engineering. Intended for Use in Universities and in Colleges of Engineers, Cambridge : Deighton, 1841.
- Wolf, C. J. E., Mémoires sur le pendule…, 2 parties, Paris : Gauthier-Villars, éd. 1889-91.
[1]. [NdT] Il s’agit ici de la revue Science in Context, dans lequel cet article est paru en anglais en 1993. BibNum a acquis auprès de l’éditeur de cette revue (Cambridge University Press) les droits (payants) d’en faire la traduction et de la mettre en ligne, en hommage à Ivor Grattan-Guinness.
[2]. Grattan-Guinness [1990].
[3]. [NdT] L’expression de l’époque à laquelle l’auteur fait allusion est celle de savant – on dirait de nos jours scientifique ou chercheur.
[4]. [réf] Pour une description des activités de ce dernier, voir par exemple Smith [1979].
[5]. [NdT] Pour des raisons de commodité de lecture propres à BibNum, les références mentionnées par l’auteur dans le texte anglais ont été reportées en note de bas de page dans la traduction française, précédées de la mention [réf]. L’ensemble des références figure en annexe à l’article.
[6]. [réf] Grattan-Guinness [1990a]. Voir notamment le chap. 2, sur les institutions ; les chapitres 8 & 16, ou l’activité d’ingénieur joue un rôle majeur ; le chapitre 19, pour des conclusions générales à propos de la communauté globale des mathématiciens, où apparaît l’ingénieur-savant ; enfin le chapitre 20, pour la transcription de documents pertinents. D’autres aspects des mathématiques de l’ingénieur sont abordés dans d’autres chapitres.
[7]. Pour une biographie de Borda, avec une quantité importante d’informations (pas toujours exactes) sur d’autres ingénieurs-savants de la fin du XVIIIe siècle, voir Mascart [1919]. Leurs successeurs comprennent non seulement les personnalités décrites dans le présent article, mais aussi un nombre considérable d’hommes de moindre importance mais de grand intérêt pour l’histoire de l’ingénierie et de l’éducation. Je citerais en particulier J.-B. Bélanger, B. Brisson, G.A. Borgnia (d’origine italienne), et G.-J. Christian. Certains d’entre eux sont mentionnés dans Picon [1991], en relation avec l’école et le corps des Ponts et Chaussées ; des études d’une qualité équivalente sur les Mines et les corps militaires seraient bienvenues.
[8]. [réf] Grattan-Guinness [1989].
[9]. [réf] Voir à ce propos Kuhn [1976].
[10]. [réf] Fox [1974] sur la partie liée à la physique ; Grattan-Guinness [1990a] à propos des mathématiques.
[11]. La matière de cette section est développée dans Grattan-Guinness [1990a], principalement dans le chapitre 2 et dans les pages 634-39 et 1125-28 (un résumé apparaît dans Grattan-Guinness [1988]). Les informations données ici puisent leur origine dans diverses sources d’archives, auxquelles je ne peux faire référence que de manière générale, dans des notes de bas de page à suivre. Dans la littérature historique sur laquelle je m’appuie, deux sources méritent une mention spéciale : Crosland [1967], où l’on peut trouver une fine enquête sur les institutions éducatives de cette période ; et une recension d’époque, non signée (« Recension, 1830 »). En accord avec le fâcheux méta-contexte décrit en section 1.1, la plupart des autres sources sont très redondantes, ou sans intérêt, ou pire encore ; les écoles d’application (section 3.1) ont été les plus négligées.
[12]. Au cours de ce siècle, l’École des Mines est devenue un centre important pour les mathématiques (curieusement, il semblerait que les mathématiques pures soient les principales concernées par cette évolution). H. Poincaré (1854-1912) est une figure intéressante, à cheval entre les époques, représentant par excellence les mathématiques AMP de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, bien qu’il fût officiellement « ingénieur des mines » et qu’il travaillât occasionnellement dans ce domaine minier.
[13]. Voir notamment la thèse remarquable de Picon (1991). La thèse de Bradley (1984), centrée sur Prony, directeur de l’École, a également beaucoup de mérite ; Bradley en a repris certaines parties, qui décrivent l’école elle-même, dans ses travaux de 1985.
[14]. Les archives riches et bien ordonnées de l’école de Metz attendent l’attention des historiens au Service Historique de l’Armée de Terre, Château de Vincennes, dossiers Xe 50-100.
[15]. [réf] Grattan-Guinness 1990, 1105-12.
[16]. Une fois de plus, la littérature secondaire est insuffisante. Artz [1966] apporte des informations précieuses sur l’histoire de l’éducation technique en France d’un point de vue global jusqu’en 1850. Sur les premières années de l’École centrale, voir Pothier [1887]. Weiss [1982] prétend être une histoire de cette école mais est très incomplet et trompeur sur les mathématiques et la mécanique ; cependant l’ouvrage est très utile quant à l’éducation technique en France au début du XIXe siècle.
[17]. [réf] Smith [1990].
[18]. [réf] Pelot [1958] ; Picon [1988].
[19]. [réf] Locqueneux [1990].
[20]. Bigourdan [1928-31].
[21]. Les dossiers fascinants des carriers de ces ingénieurs pendant cette période sont aux Archives Nationales F18, principalement 2146-2341, 2712-40.
[22]. Les dossiers correspondants sont tenus à Vincennes, dans les services de l’armée de terre et de la marine.
[23]. À nouveau, très peu de travaux existent concernant le secteur de l’édition scientifique en général. Dhombres [1985] apporte quelques informations sur les manuels ; Grattan-Guinness [1990a] contient des données sur de nombreuses publications individuelles. Voir aussi note suivante.
[24]. Le premier tirage, habituel pour un périodique scientifique, comptait 1000 exemplaires (Journal général, 1811-12, 339). La principale et unique source d’informations sur les tirages, aussi bien des périodiques que des livres, provient des nombreuses déclarations de l’imprimeur (incomplètes mais considérables), conservées aux Archives nationales, F15 1-41. Les historiens ne les ont pratiquement pas exploitées.
[25]. [réf] Voir Grattan-Guinness [1990c], comprenant une bibliographie étendue de littérature secondaire.
[26]. [réf] Poncelet 1852 ; Kŏtter 1892 ; Heyman 1792.
[27]. [réf] Rühlmann 1881-85 ; Grattan-Guinness 1984 et 1990a, en particulier le chap. 16.
[28]. [réf] Acloque 1981.
[29]. [réf] Grattan-Guinness 1990a, 388-92.
[30]. Biot et Arago ont eux aussi utilisé ces instruments dans les années 1810 et 1820 lors de leurs travaux pour étendre la méridienne de P.F.A. Méchain et Delambre des années 1790. Pour ces travaux et les travaux connexes, voir Grattan-Guinness 1990a, 339-44, 424-28.
[31]. Pour les différentes utilisations du pendule par les Français, voir ibid., 424-31. Plus tard, des personnages similaires dans d’autres pays, dont F.W. Basel en Allemagne et G. G. Stokes en Angleterre, ont poursuivi ces études. Wolf 1889-91 a composé une bibliographie inestimable et une étude sur la théorie et la pratique du pendule.
[32]. Voir Grattan-Guinness 1990a, 461-70 (première période), chap. 15 (deuxième période), pp. 1239-42 (développements plus tardifs), et pp. 549-50 (Dupin). Les écrits historiques sur ces découvertes sont plutôt décevants : Todhunter [1886] 1966 demeure une source importante, quoique perfectible.
[33]. [réf] Grattan-Guinness 1990a, 969-1003.
[34]. On devrait accorder plus d’importance que d’habitude aux litiges sur la propriété dans l’étude de la science française ; en effet, ils ont pu considérablement affecter les initiatives immédiates et les motifs des personnages historiques, d’une manière propre à la vie intellectuelle parisienne.
[35]. [réf] Picon 1991, chap. 10.
[36]. [réf] Grattan-Guinness 1990a, 998-1000.
[37]. [réf] Boyer 1956.
[38]. [réf] Taton 1951, chap. 3-5.
[39]. [réf] Booker [1963] 1978, chap. 9-10.
[40]. [réf] Voir l’ironique Loria 1921.
[41]. [réf] Kötter 1901.
[42]. [réf] Daston 1986.
43. Prony [1835] ; sur les contrastes du contenu pédagogique au cours des premières années d’existence de l’École polytechnique, voir Grattan-Guinness 1990a, p. 127-44, 195-200, 223-25. Cependant, soulignons que Lagrange a élaboré sa fameuse formule d’interpolation dans les années 1790 (pp. 176-77).
[44]. [réf] Et partiellement transcrits dans Grattan-Guinness 1990a, 1337-40),
[45]. [réf] Grattan-Guinness 1990a, 661-82.
[46] [NdT] Sur Girard et le canal de l’Ourcq, voir le texte de Margaret Bradley dans BibNum, mai 2014.
[47]. [réf] Girard 1831-43.
[48]. [réf] Mouret 1921 ; Grattan-Guinness 1990a, 550-57.
[49]. [réf] Berthaut 1898-99, 1902).
[50]. Louis Puissant (1769-1843) n’est pas du tout mentionné chez Konvitz 1987, alors qu’il s’agit par ailleurs d’une excellente étude historique et sociale de la cartographie française ; sur ses travaux, voir Grattan-Guinness 1990a, notamment pp. 330-52, 414-18 et 1205-6.
[51]. École spécialisée en cartographie parmi celles citées dans la sous-section 3.2. Prony a dirigé l’établissement précédent de 1792 jusqu’à sa fermeture en 1803. Pour l’histoire de l’enseignement de la cartographie en France, voir Bret 1991.
[52]. [réf] Grattan-Guinness 1990d et brièvement 1990a, 179-83).
[53]. [réf] Pour plus de détails sur ces cas et d’autres exemples, voir Grattan-Guinness 1990a, 1204-19.
[54]. [réf] Franksen et Grattan-Guinness 1989.
[55]. L’ignorance en la matière va de pair avec l’échec des historiens à remarquer l’École de Metz (mentionnée dans la sous-partie 3.1) ; pour un bref aperçu de leurs résultats, voir Grattan-Guinness 990a, 1248-52. Notons qu’il s’agit de cinq ingénieurs-savants ; parmi les autres membres du groupe CMI, Dupin appartenait au Génie maritime. Dans le groupe AMP, seul Malus a conservé un statut militaire tout au long de sa vie. Globalement, les études sur l’histoire de la science militaire sont loin d’être aussi poussées qu’elles devraient l’être. Ainsi, il n’existe actuellement presque aucune étude historique sur les mathématiques militaires. Henry Barnard a été un chroniqueur précieux pour les politiques pédagogiques des écoles militaires du monde entier vers le milieu du XIXe siècle ; voir notamment Barnard 1862, 1872 [NdT : on peut consulter néanmoins avec profit B. Belhoste et L. Lemaitre, « J.-V. Poncelet, les ingénieurs militaires et les roues et turbines hydrauliques », Cahier d’histoire des sciences et des techniques, 1990 (lien)]
[56]. Ces deux paires de volumes ont été publiées dans les dernières années de la vie de Poncelet, mais ils contiennent des travaux réalisés bien plus tôt, entre 1813 et 1831. Le premier volume du Traité a été publié en 1822, et certains passages des Applications avaient été publiés à la même époque dans des revues.
[57]. [réf] Gillmor 1971, Heyman 1972
[58]. [réf] Bradley 1981.
[59]. Pour ces interrogations, la meilleure source est le Journal du génie civil, des sciences et des arts, car il s’intéresse explicitement au statut de la profession. Voir par exemple « Quelques réflexions », 1829, et « Lettre au Directeur du journal », 1829.
[60]. « Central » est un terme technique dans le jargon administratif français qui se réfère à une direction nationale exercée depuis Paris, ou exercée depuis la préfecture sur le département.
[61]. Soulignons ici la notion de « recherche » : les tâches d’enseignement du poste détenu par le savant pouvaient impliquer des problématiques propres à l’autre groupe que celui auquel appartenaient ses recherches. Par exemple, comme nous l’avons établi dans la sous-partie 4.3, de nombreux membres AMP enseignaient ou siégeaient au jury de géométrie descriptive à l’École polytechnique, en particulier dans ses premières années ; cependant, ils ne s’intéressaient pas ou peu au développement de cette discipline en tant que branche des mathématiques, ni même à son utilisations dans leurs propres recherches.
[62]. Gauss a travaillé sur une potentielle théorisation (et en est devenu le pionnier) en adoptant une approche AMP, en partie sous l’influence de ses prédécesseurs français tels que Lagrange, Laplace et Legendre (Geppert 1993, art. 3). Cependant, pour l’astronomie, il a préféré une méthodologie plus pratique et plus numérique afin de déterminer (avec précision) les paramètres et les orbites (voir par exemple Gauss 1809, livre 2 et annexe). Cette approche est aussi visible chez d’autres mathématiciens-astronomes allemands tels que J. C. Encke, H. W. M Olbers et J. G. Von Soldner. Elle est également en accord avec les pratiques des membres CMI tels que de Prony, Puissant et Francoeur. Elle forme un contraste frappant et probablement prémédité avec les tendances du groupe AMP, surtout alimentées par Laplace, visant à des déterminations et des solutions supposées « exactes » sous la forme développements trigonométriques de variables paramétriques. Sur cette différence, voir Grattan-Guinness 1990a, 312-30, 386-418 ; le contraste avec les Allemands est souligné pp. 386-87.
[63]. Un grand nombre des publications scientifiques de Whewell répondent aux normes AMP : ses multiples traités sur la mécanique newtonienne repensée (1819-33), ses articles sur la théorie des marées (1823-30, post-Laplaciens mais aussi anti-Laplaciens sous certains aspects) et son article non signé ([Whewell] 1830) dans l’Encyclopaedia metropolitana, où il esquisse la théorie des fonctions de Legendre. Mais dans Whewell 1841, il s’est également pris d’enthousiasme pour la mécanique énergétique, étudiée par des membres CMI tels que Poncelet et Coriolis (sous-section 4.1), et il en a dans une certaine mesure été le pionnier en Angleterre. Pour une étude du contexte du travail de Whewell et de ses contemporains à Cambridge, comprenant une bibliographie complète listant les livres et les articles principaux et un état des lieux des différentes tendances pour le calcul et ses applications, voir Grattan-Guinness 1985.
[64]. Cette figure majeure des sciences britanniques du XIXème siècle, sur laquelle les études manquent sérieusement, a montré très tôt de l’intérêt pour les deux groupes (voir ibid. pour les références et le contexte). La collection de « traités mathématiques » d’Airy (1826) contenait entre autres le premier compte-rendu conséquent sur la théorie des ondes lumineuses de Fresnel ; en 1838, une étude de la caustique l’amena à formuler « l’intégrale d’Airy » qui reprenait les intégrales de Fresnel de 1816 (élaborées au cours d’études sur la diffraction ; Grattan-Guinness 1990a, 863-66). De plus, il a écrit un essai majeur (et hautement anti-Laplacien) sur la théorie des marées dans l’Encyclopaedia metropolitana. Mais il était également à l’aise avec de nombreuses facettes appartenant au domaine CMI, sa contribution la plus notable étant son analyse innovante des régulateurs servo-mécaniques (Fuller 1975). Des similitudes avec un autre « chevaucheur de groupes », J. C. Maxwell, s’imposent ici.
[65]. Par exemple, comparer Thomson-AMP et sa « théorie dynamique de la chaleur » ([1851-53] 1882), très proche des travaux de Fourrier, avec Thomson-CMI et ses travaux sur « le marégraphe, l’analyseur harmonique des marées et le prédicteur de marées » ([1882] 1911), sur la base mathématique des premiers termes du développement de séries trigonométriques. Les problématiques fondamentales concernant les différences dans les approches mathématiques méritent d’être étudiées, mais nous ne pouvons pas recommander la biographie récente Smith et Wise 1989 : de la manière habituelle et déprimante propre au méta-contexte décrite dans la sous-section 1.1, cette étude remarquablement détaillée est profondément entachée par un chapitre 6 sur « Le [sic] langage de la physique mathématique » où règne la confusion des tendances du calcul et des applications, confusion que Kelvin a lui-même entièrement évitée dans ses écrits.
[66]. Voir notamment Ben-David 1970, Outram 1980. Ce premier essai est erroné, voire trompeur, sur de nombreux aspects institutionnels.
[67]. C’était l’opinion de Poncelet. Dans le cadre d’une réforme de la Faculté des sciences de l’Université, il a été nommé, en 1837, à une nouvelle chaire en « mécanique physique et expérimentale ». Cependant, son enseignement eut peu de succès, et il démissionna en 1848 dans une lettre splendide qui fut publiée à l’époque (Poncelet [1848] 1936) et dans laquelle il déplorait « la division déplorable de l’enseignement public en France », entre science appliquée et science théorique.
[68]. Ce point très intéressant de l’histoire des politiques scientifiques n’a pas été soumis aux études qu’il mérite. H. Paul (1972), un historien qui propose une exception bienvenue à la croyance au déclin, en offre un aperçu ; cependant, il ne fait que mentionner les mathématiques et n’examine pas leur développement au niveau de la recherche ou de l’éducation. Hulin-Jung 1989 fournit quelques informations documentaires sur l’Université à la moitié du XIXe siècle.
Ouvrage [en anglais]
|
|
|
Ouvrages
 |
|
|
|
|
|
|
|
148-igg-vf.pdf

grattan_texte.pdf